Traduit par Rabia R-Toraubally
Le lundi 10 décembre 1979, par un froid glacial, l’air de Stockholm semblait refléter le caractère formel et austère qui régnait dans la grande salle où se déroulait la cérémonie de remise des prix Nobel. Une salle royale baignée d’une lumière tamisée, où se côtoient des costumes noirs et des visages solennels — des hommes représentant le summum de l’excellence occidentale dans le domaine scientifique, dont les expressions sont marquées par le poids de leurs études, de leur raison d’être et de leur intellect. Une atmosphère chargée de traditions implicites y règne comme une norme stricte de conformité inscrite dans le moindre point de confection. Et là, au milieu de cette ambiance monochrome, se trouve le Dr Abdus Salam, revêtu de la richesse de son identité, paré d’un turban et d’un sherwani et qui rayonne non pas de provocation, mais d’un sentiment inébranlable d’appartenance. Sa présence est à la fois une bizarrerie et une affirmation : l’excellence n’exige pas que l’on efface ses racines.
Né dans la modeste ville de Jhang, dans l’Inde britannique, le parcours du Dr Salam n’a pas seulement été jalonné par des équations et des théories, mais aussi par un dévouement sans faille à sa foi et à son héritage. Des rues poussiéreuses du Pendjab aux sols impeccables de Stockholm, il a porté avec lui non seulement la brillance d’un physicien, mais aussi la dignité d’un homme profondément enraciné dans son identité spirituelle et culturelle. Sa peau, sa foi et son héritage culturel le rendaient différent, mais c’est précisément cette différence qui rendait sa présence puissante, une déclaration silencieuse selon laquelle l’excellence n’exige pas la conformité.
Quel est le point commun entre un physicien lauréat du prix Nobel et le voile islamique ? À première vue, ils peuvent paraître très éloignés l’un de l’autre : un homme paré du prestige que confère le génie scientifique tandis que l’autre est un vêtement porté par les femmes musulmanes. Pourtant, lorsqu’on creuse un peu, on découvre un lien profond : le courage d’assumer son identité sans complexes face aux pressions de la société.
Lorsque l’on est l’intrus, celui qui défie le système, il est facile de tomber dans le piège et de se demander : « Qu’est-ce qu’ils vont penser de moi ? ». Mais au fond des cœurs des observateurs, ils ont souvent un respect discret, voire une admiration, pour le courage qu’il faut pour se démarquer. L’histoire nous a montré que ceux qui font avancer l’humanité sont ceux-là mêmes qui ont osé être différents, qu’il s’agisse d’un scientifique qui a exploré de nouveaux territoires avec de nouveaux paramètres révolutionnaires et qui a osé se différencier au sein de la communauté scientifique, ou d’une musulmane qui défie les tendances de la mode et affiche sa dévotion par le biais du voile islamique. Ces deux choses sont-elles vraiment si différentes dans leurs principes fondamentaux ?
Le monde peut retenir de nombreuses leçons importantes du Dr Salam, un homme dont le brio lui a valu une reconnaissance mondiale, mais dont le dévouement inébranlable à l’égard de sa foi a laissé une empreinte tout aussi importante. Son parcours ne se limite pas à la réussite scientifique ; il témoigne également de la puissance transformative de la confiance en soi, de l’authenticité et de la force que l’on trouve en embrassant ses racines.
Le Dr Salam a reçu son prix Nobel de physique en 1979, fièrement vêtu d’une tenue traditionnelle, et citant une prophétie du Messie Promis (a.s.), entremêlant ainsi parfaitement la foi et le succès intellectuel. Au-delà d’un simple acte d’expression au niveau personnel, il s’agissait d’une démarche audacieuse visant à démontrer que l’identité religieuse et culturelle d’une personne n’a pas besoin d’être sacrifiée pour parvenir à l’excellence.
Cette représentation suscite une réflexion frappante : si un homme de son envergure, se tenant sur l’une des scènes les plus prestigieuses du monde, peut parler de sa foi avec fierté, pourquoi les femmes musulmanes devraient-elles se sentir gênées lorsqu’elles portent le hijab dans leur vie de tous les jours ?
Le legs de Dr Salam témoigne de la problématique universelle de la quête d’identité dans des espaces qui exigent le conformisme. Son histoire ne concerne pas seulement les musulmans ou les scientifiques, mais toute personne qui s’est déjà sentie obligée de dissimuler certaines parties d’elle-même pour se faire accepter. Il a incarné l’intégrité, démontrant que le véritable respect ne consiste pas à se fondre dans la masse, mais à rester fidèle à qui on est.
Dans bien des cas, le hijab est incompris. On le réduit à des stéréotypes sans tenir compte de sa véritable signification. Pour de nombreuses femmes musulmanes, il représente plus qu’un simple morceau de tissu : c’est un symbole de force, de dignité et de dévotion. Il revêt le poids émotionnel d’un choix personnel, d’un lien spirituel et du courage quotidien d’être visible dans sa foi. Tout comme le turban du Dr Salam, le hijab témoigne du refus d’être invisible ou de se soumettre aux attentes de la société.
L’histoire nous a montré que la diversité de pensée, de culture et d’expression favorise l’innovation et le progrès. Par ailleurs, l’authenticité engendre la confiance, et la confiance est le moteur de la réussite. Que ce soit dans le domaine de la science, de l’art ou du progrès personnel, ce sont souvent ceux qui assument leur véritable identité qui exercent une influence profonde et durable. Les contributions scientifiques du Dr Salam n’ont pas été limitées par sa foi ; au contraire, son identité complète a enrichi sa vision du monde et a alimenté sa passion pour la recherche.
À propos de l’auteure : Farva Mubashir est une étudiante diplômée, titulaire d’un « Baccalauréat ès sciences (avec distinction) en psychologie et d’une Maîtrise ès sciences en psychologie et psychiatrie culturelle. Elle poursuit actuellement un Master en intervention précoce dans le domaine de la psychose au King’s College de Londres, ainsi qu’un Master en droit à l’université d’Oslo. Passionnée par la théologie, la psychologie et le droit, elle explore la manière dont la foi, la logique et le comportement humain se croisent pour façonner les sociétés ainsi que les structures morales.






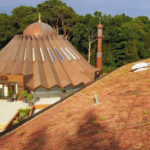




Commentaires récents